 J’ai commencé à l’écrire alors que j’avais atteint ma
majorité. En soi, il n’y a aucun lien à faire entre ces deux événements ;
c’est juste qu’à cette époque, on venait de me filer une splendide machine à
écrire électrique et que probablement, l’idée de signer la fin d’une ère passée
à m’écraser l’index, le majeurs et le pouce sur les touches mécaniques de mon
antédiluvienne Olivetti m’a particulièrement motivé : peut-être, en
arrêtant de devoir décoincer les barres de frappe tous les dix mots, j’allais pouvoir
enfin ne me concentrer que sur l’écriture sans que le résultat ne se résume à
un étagement de lignes biscornues sur lesquelles pas une lettre n’a la même
densité que la suivante ?
J’ai commencé à l’écrire alors que j’avais atteint ma
majorité. En soi, il n’y a aucun lien à faire entre ces deux événements ;
c’est juste qu’à cette époque, on venait de me filer une splendide machine à
écrire électrique et que probablement, l’idée de signer la fin d’une ère passée
à m’écraser l’index, le majeurs et le pouce sur les touches mécaniques de mon
antédiluvienne Olivetti m’a particulièrement motivé : peut-être, en
arrêtant de devoir décoincer les barres de frappe tous les dix mots, j’allais pouvoir
enfin ne me concentrer que sur l’écriture sans que le résultat ne se résume à
un étagement de lignes biscornues sur lesquelles pas une lettre n’a la même
densité que la suivante ?Ceci dit, comme j’avais des velléités de graphiste, j’ai décidé très stupidement d’opter pour un format A5, ce qui donnait à mon tapuscrit, pensais-je, une sorte de touche « éditeur ». Bon, en matière de format A5, je me contentai de plier des feuilles standard en deux, qui formaient ainsi des sortes de cahiers de 4 pages successives que j’envisageais de ligoter entre eux à l’aide de petites ficelles pour aboutir, au final, à un « ouvrage relié ». Je n’avais bêtement pas anticipé que la pression monterait jusqu’à atteindre un climax à chaque dernière « page » de chaque cahier, chaque faute de frappe, couac ou mauvais engagement de feuille mettant en péril les trois feuillets précédents : ce que je venais de gagner en aisance avec l’électrique, je le perdis avec mon judicieux « système A5 ».
Trois ans plus tard, mon tapuscrit
presque achevé, je suis obligé de marquer une pause parce que je pars dans
l’Est chanter des chansons entraînantes avec de nouveaux camarades : nous
sommes habillés pareil, nous marchons dans la neige à la queue-leu-leu, nous
buvons beaucoup de boisson gazeuse et occasionnellement, nous tirons des balles
de 5,56 mm dans des troncs d’arbres. Ayant fini par me lasser (oui, on arrive
parfois à se lasser des choses les plus sympathiques), je quitte mes amis de la
forêt pour rejoindre d’autres nouveaux amis qui passent la plupart de leur
temps dans un bunker. Nous y sommes tous habillés pareil, nous marchons dans
des couloirs étroits en baissant la tête, nous buvons beaucoup de boisson
gazeuse et occasionnellement, nous tirons des balles de 9 mm sous de grands
hangars, d’autres de 7,62 mm ou de 12,7 mm depuis des camions, on jette aussi
de gros pétards le plus loin possible, bref, on s’occupe. Des fois, on se
bagarre un peu aussi. Mais de temps en temps, je peux rester assis dans un
petit bureau sans fenêtre équipé… d’une machine à écrire électrique.
Chouette : je parviens à finir mon tapuscrit. Sauf que toute cette vie au
grand air, puis sans plus d’air du tout, ça m’a donné des idées. Alors, je
recommence depuis le début. Ce sera la première fois (mais hélas, pas la
dernière) : je décide notamment, par pure coquetterie, de brouiller les
pistes en mélangeant la chronologie du récit. Me voilà à la tête d’un labeur ayant
pour but de « fouetter la lecture » en rajoutant des chapitres de
transition qui devront maintenir une force rythmique essentielle à ce nouvel
ordonnancement.
Quand je quitte tous ces camarades avec une splendide
médaille autour du cou, une obligation théorique de revenir près du bunker tous
les cinq ans et un petit carton bleu qui précise qu’en cas de guerre, en ma
qualité de chef (si si…) il faudra que je retourne tout de suite dans la forêt
avec mes anciens camarades de forêt du début, mon tapuscrit est fini : relié
avec ses petites ficelles, enchâssé dans un superbe étui en carton fabriqué
main et orné d’une jaquette sur-collée de photos qui en jettent. Bref, une
sorte de vrai livre de 100 pages précisément. Sauf que c’est un modèle unique.
Quand je le reprends en main aujourd’hui, j’ai l’impression de manipuler une
relique.
Ensuite, ce seront les avancées
technologiques qui traceront la destinée de cette mouture initiale du 4ème
H parce qu’elles aboutissent systématiquement au même résultat :
quand une année plus tard je me décide à re-saisir cet ouvrage dans
l’excitation de l’achat d’un MacIntosh de modèle « Classic », le
recul me fait réaliser que le texte est un peu obscur et que quelques
explications ne seront pas de trop. Je remodifie donc le texte pour la seconde
fois, cette fois en profondeur : après avoir découpé chaque feuillet des
fameux « cahiers » pour remettre les chapitres en ordre chronologique,
je me mets à ajouter des photos, des légendes et des dessins, et j’étoffe lourdement le propos
en créant des « univers dans l’univers ». Le travail est harassant et
sans le savoir, je viens de mettre les doigts dans le terrible engrenage du
numérique qui, cumulé à mon insatisfaction maladive, déclare l’ouverture d’une
nouvelle ère en termes de méthodologie d’écriture : l’éternel inachevé.
Au départ, c’est fascinant : pouvoir revenir en un
simple « clic » sur un mot, une phrase, effacer des paragraphes
entiers, les déplacer à l’intérieur du texte, essayer des possibilités
rythmiques et y revenir dessus est une forme de liberté d’écriture inespérée,
qui devient une sorte d’ivresse, puis me rend fou : là où le poids d’un
mot ou d’une phrase avait toujours eu à se jouer dans ma tête avant
d’apparaître « gravé » sur papier, voilà que l’informatique offre,
avec toutes ses libertés de travail, un cadeau empoisonné : le texte
devient « virtuel », et ne peut finalement jamais aboutir à une forme
définitive. (Cet aspect-là du numérique s’est d’ailleurs imposé partout :
photographies jetables déclenchées à l’infini et supprimées à l’envie,
conversations téléphoniques inutiles et chronophages, abandon massif des
capacités mémorielles, distillation et paupérisation de toutes les formes
d’arts : le numérique est la véritable boîte de Pandore du XXème siècle.
Allumez un ordinateur au milieu des années 90, et attendez que les fléaux
s’abattent sur votre cortex.)
Le 4ème H devient
lentement autre chose à l’intérieur de mon Mac Intosh. D’un petit essai à
caractère surréaliste mâtiné de (pas terrible) philosophie anticipative, il
évolue en un hybride fourmillant de références, de tentatives et de
théoricismes décousus, une sorte de proto-roman dystopique. Le piège se
referme : en tentant d’expliquer ce qui ne devait pas l’être, les
incohérences s’enchaînent les unes aux autres, appelant elles-mêmes d’autres
explications, qui génèrent elles-mêmes de nouvelles idées à apporter. Le récit
se complexifie grandement, de nouveaux personnages font leur apparition qui,
pour des raisons de cohérence, obligent à remodifier en permanence les
chapitres apparemment clos.
L’achat du modèle de Mac Intosh
suivant, le célèbre LC II avec son disque dur « pizza box », entérine
le phénomène : la disquette contenant la version réadaptée sur
« Classic » dévoile un fichier
au contenu passablement boiteux : Le 4ème H a gagné une lourde
centaine de pages, mais a perdu le
charme du tapuscrit sans parvenir à lui opposer une fluidité ni une tension
suffisantes à ma satisfaction. Je recommence, déterminé à venir à bout de tous
les chantiers lancés naïvement dans la version précédente. En 2001, une
première version de ce qui deviendra la « forme finale » est
achevée : le roman se divise désormais en tomes, grâce auxquels je pense
avoir réussi à surmonter les incohérences nées de la deuxième réécriture en
ayant scindé le récit en trois thèmes, trois ambiances et trois rythmes
différents. J’ai en main un projet de roman/saga de bon augure…
C’est le moment que mon entourage choisit pour
m’acheter mon premier ordinateur « portable » : un Toshiba
Satellite. J’entame avec cet objet manufacturé une relation fusionnelle
augurant du XXIème siècle à venir, qui passe, forcément, par une quatrième
réécriture du 4ème H : je constate, amer mais néanmoins motivé,
que diviser un écrit en trois volumes entraîne la nécessité que chaque volume
soit intrinsèquement riche, cohérent et palpitant, ce qui n’est objectivement
pas le cas. Ceci dit, j’entame cette nouvelle mouture alors que je m’enfonce
corps et âme dans l’univers de la musique : ma vie se met à devenir une
succession de journées administratives pénibles suivies de nuits de bruits, de
fureurs, d’ivresses et de décibels. Peu de place pour le calme, la
concentration et le temps nécessaire à ce type de projet. Après deux vaines
tentatives, j’abandonne Le Quatrième H dans le disque dur de mon objet fétiche.
J’ai beau me doter d’un Sony Vaio
blanc immaculé (avec lequel j’écris d’ailleurs encore ces lignes), et
transbahuter une fois de plus l’ouvrage en friche à l’intérieur, rien n’y fait.
Les versions successives de 2005 à 2008, que je ne compte plus, s’engluent dans
des modifications stériles, des abandons stupides et des redondances qui ne
sont plus maîtrisables. Les dizaines de micro-univers, les entrelacs de
personnages et de temporalités, les intrigues, l’ambition stylistique, rien ne
va plus : le travail me paraît insurmontable. Déçu, je me mets, à la
place, à écrire des chansons : l’écriture de paroles supplante mon roman-fleuve
boueux tout en légèreté… et en pragmatisme.
Il faut attendre une réaction
épidermique à cette interminable décennie de bruits, de fureurs et de nuits
pour qu’un profond processus de décroissance me conduise à ré-inventer mon
quotidien : je reprends du temps sur le temps, et fatalement, retrouve mon
si cher 4ème H assez embouti, mais toujours aussi à mon goût. Alors
je m’y remets.
Je noircis des centaines de nouvelles pages, je me
replonge dans des recherches ardues, je me documente, je lis, je transcris,
j’annote, je repère, j’ordonnance, une dernière fois. Et cette fois encore,
j’échoue. Près du but, mais j’échoue. La tâche est devenue trop vaste,
l’ambition démesurée, et mes exigences, difficilement satisfaites. Plus ou
moins par désœuvrement, j’ouvre alors un Blog fourre-tout, « La Petite
M. », et dans la foulée, je quitte mon travail.
Il y a quelques mois enfin, je
suis mis en contact avec Philippe Hauer des éditions Vanloo par le biais du
brillantissime Oh! Tiger Mountain que j’ai eu la chance de compter un temps
parmi mes amis. Je me résous à lui envoyer deux manuscrits : une
compilation de dialogues dadaïstes parus sur mon blog… et le manuscrit inachevé
du Quatrième H.
Les « Egodialogues » sont depuis parus dans
la collection "Chroniques" des éditions VanLoo.
Mais dès lors aussi, parce que Philippe Hauer m’y
pousse, le terrassant labeur reprend, augurant cette fois de l’émergence
définitive d’une œuvre ayant monopolisé pas moins de vingt-cinq ans de vie, et
d’inspiration, sur un même sujet : la fascination pour ce que l’homme a de
gargouillant et de médiocre, sans jamais omettre d’éclairer ses errances
d’éclairs célestes traversant furtivement une vision fantomatique de l’avenir.
Tenez-vous prêts, amis lecteurs. « La Règle
Primitive », le premier tome de la saga « Le Quatrième H », est
prévue pour début 2015.

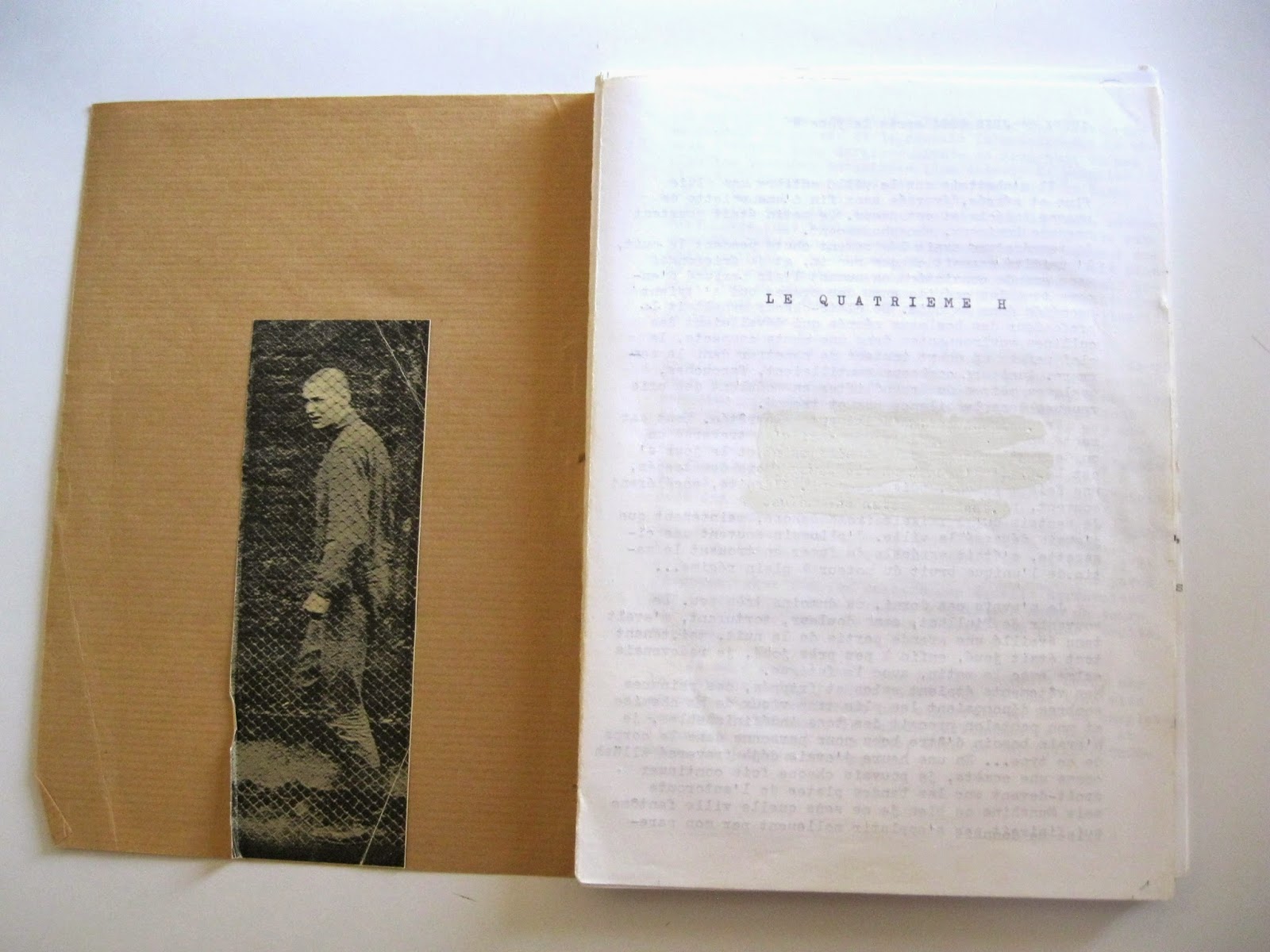
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire