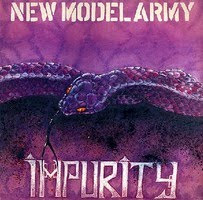Dimitri Sokolov-Mitricht, au-delà d’avoir, pour tout amateur de romantisme russe, un nom qui fait voyager l’imagination, est journaliste à l’Izvestia de Moscou ; il se trouve aussi que «Courrier International nous relate que Dimitri Sokolov-Mitricht a mené une expérience pamphlétaire contemporaine, version slave : à l’opposé du procédé forcément « bigger than life » de l’américain Morgan Spurlock et de son pamphlet « Supersize me », Dimitri Sokolov-Mitricht s’est contenté d’une semaine passée « dans un studio ordinaire de type soviétique », avec pour mot d’ordre un quotidien quasi monacal destiné à éprouver une vie au consumérisme limité à l’extrême.
Résultat ? Là où l’américain s’astreint à trente jours d’expérimentation pour parfaire sa démonstration de la folie nutritionnelle qui s’empare de son pays et livre un film-documentaire témoignant de la menace qu’il a fait peser sur sa propre santé, le russe se contente d’une semaine d’immersion pour délivrer un article, sans avoir altéré aucune de ses facultés. Les deux méthodes fonctionnent pourtant aussi bien l’une que l’autre, chacune finissant par sensibiliser un vaste public. Fond contre forme ? Le russe écrit notre relation passionnelle aux objets au travers d’une privation qu’il s’inflige, l’américain filme notre relation addictive à la nourriture au travers d’une surconsommation qu’il s’inflige. Est-ce là une antépénultième preuve de ce manichéisme hérité des 60’s se complaisant dans l’opposition d’un supposé naturel extraverti de l’Ouest avec un tout aussi supposé pragmatisme introverti de l’Est ? Alors que les deux démarches visent un but quasi-similaire, suis-je plus touché par Dimitri Sokolov-Mitricht que par Morgan Spurlock parce que :
- Je ne mange que peu de junk-food, et que je préfère légitimement un ragoût d’agneau au thym à un menu « super size » (rappel : notre chaîne de restauration rapide nationale vient de lancer sur le marché un tout nouveau sandwich « X-Tra Long »…)
- Je ne suis que moyennement consommateur de cette mode de film-documentaires qui assènent des vérités (souvent catastrophisantes et systématiquement culpabilisantes) sur un monde bizarrement conscrit dont nous chevauchons tous la dérive
- Je préfère sans grande hésitation l’écrit à l’image
- Je préfère Michel Strogoff à Jason Bourne.
Résultat ? Là où l’américain s’astreint à trente jours d’expérimentation pour parfaire sa démonstration de la folie nutritionnelle qui s’empare de son pays et livre un film-documentaire témoignant de la menace qu’il a fait peser sur sa propre santé, le russe se contente d’une semaine d’immersion pour délivrer un article, sans avoir altéré aucune de ses facultés. Les deux méthodes fonctionnent pourtant aussi bien l’une que l’autre, chacune finissant par sensibiliser un vaste public. Fond contre forme ? Le russe écrit notre relation passionnelle aux objets au travers d’une privation qu’il s’inflige, l’américain filme notre relation addictive à la nourriture au travers d’une surconsommation qu’il s’inflige. Est-ce là une antépénultième preuve de ce manichéisme hérité des 60’s se complaisant dans l’opposition d’un supposé naturel extraverti de l’Ouest avec un tout aussi supposé pragmatisme introverti de l’Est ? Alors que les deux démarches visent un but quasi-similaire, suis-je plus touché par Dimitri Sokolov-Mitricht que par Morgan Spurlock parce que :
- Je ne mange que peu de junk-food, et que je préfère légitimement un ragoût d’agneau au thym à un menu « super size » (rappel : notre chaîne de restauration rapide nationale vient de lancer sur le marché un tout nouveau sandwich « X-Tra Long »…)
- Je ne suis que moyennement consommateur de cette mode de film-documentaires qui assènent des vérités (souvent catastrophisantes et systématiquement culpabilisantes) sur un monde bizarrement conscrit dont nous chevauchons tous la dérive
- Je préfère sans grande hésitation l’écrit à l’image
- Je préfère Michel Strogoff à Jason Bourne.
(liste non exhaustive).
Bref, voilà cet article intitulé : « Huit jours de bonheur loin de la consommation »
« Vous savez quel a été le plus grand pied que j’ai pris cette année ? Mon réveillon en Autriche ? Non. Mon reportage sur le Baïkal, au frais, pendant que Moscou étouffait dans la canicule et la fumée des incendies ? Non plus. La semaine où je me suis le plus régalé a été celle que j’ai passée tout seul dans un studio ordinaire de type soviétique, avec un canapé-lit, une table, un tabouret, une baignoire, un évier et un frigo. J’avais pris quelques sous-vêtements, un pantalon et une chemise. Je suis arrivé un vendredi et suis allé faire mes courses ; j’ai acheté à manger pour 1000 roubles [environ 24 euros], ce qui m’a suffi jusqu’au vendredi suivant. Autour de moi, rien de superflu.
« Vous savez quel a été le plus grand pied que j’ai pris cette année ? Mon réveillon en Autriche ? Non. Mon reportage sur le Baïkal, au frais, pendant que Moscou étouffait dans la canicule et la fumée des incendies ? Non plus. La semaine où je me suis le plus régalé a été celle que j’ai passée tout seul dans un studio ordinaire de type soviétique, avec un canapé-lit, une table, un tabouret, une baignoire, un évier et un frigo. J’avais pris quelques sous-vêtements, un pantalon et une chemise. Je suis arrivé un vendredi et suis allé faire mes courses ; j’ai acheté à manger pour 1000 roubles [environ 24 euros], ce qui m’a suffi jusqu’au vendredi suivant. Autour de moi, rien de superflu.
Oui, messieurs les psychiatres, je veux parler de cette expérience. J’ai l’impression que je suis en train de développer une forme intéressante de paranoïa. Et que je ne suis pas le seul. Je commence à avoir peur du superflu, des papiers, des activités, des informations et même des plaisirs qui nous assaillent. Arrivé à un certain stade de l’existence, on comprend que trop de choses inutiles et absurdes se sont amoncelées autour de nous. Et que tout cela devient agressif. On se met donc à en avoir peur.
On a du mal à contenir son irritation quand on se voit offrir des cadeaux inutiles, ou même utiles, et on insiste auprès de ses amis pour qu’ils viennent à vos soirées d’anniversaire les mains vides. Mais ils n’écoutent pas. On réagit mal lorsque notre épouse nous propose d’aller chez Mega [gigantesque centre commercial] acheter une paire de jeans neufs, parce qu’un homme comme il faut se doit d’avoir cinq ou six pantalons différents. On est horrifié devant la quantité de jouets qui a envahi la chambre des enfants. Et on comprend soudain le bonheur que ça doit représenter de remplir un grand sac d’objets divers et d’aller le balancer à la décharge.
Si vous pensez que je suis en train de déplorer à grands cris la puissance destructrice des objets, vous vous trompez. C’est exactement l’inverse. Je suis consterné de voir à quel point ils ont perdu de leur force. Parce que j’aime les objets, je veux qu’ils fassent partie de la famille au lieu de n’être que des partenaires jetables. Pour moi, pas de brève aventure ; je suis animé des intentions les plus sérieuses vis-à-vis des objets.
Personne n’est absolument détaché du monde matériel. Tout objet valable a un côté pragmatique et esthétique, mais aussi sacré. Et c’est précisément cette fétichisation que la publicité exploite. Lorsque nous contemplons la naissance du nouveau modèle d’une marque automobile mondialement connue, notre inconscient se réveille, prêt à succomber à la grandeur de cette création divine, ou du moins à communier avec cette grandeur en la possédant.
Mais le culte des objets, comme tout autre, se désacralise lorsque les dieux deviennent trop nombreux. A quand remonte la dernière fois où vous avez vraiment “arrêté votre choix” sur un objet ? Et nos enfants disent-ils, émus, à leurs copains : “C’est le parapluie de papa, celui qui les abritait, lui et ma maman, au début de leur vie commune” ? Qui se souvient encore de ce qu’est un patrimoine familial ? Nous avons même cessé de considérer les robes de mariées comme des reliques à conserver précieusement. Aujourd’hui, les articles sont tout de suite hors d’usage, et même s’ils peuvent encore servir ils vieillissent mal, passent de mode, lassent leurs propriétaires. Ils entrent chez nous pour en sortir aussitôt, comme des amants furtifs ou des filles d’un soir, sans que nous ayons le temps de nous y attacher, voire simplement de les apprécier. Du coup, nous perdons aussi le sens de la mesure dans la consommation.
C’est ainsi que les objets se multiplient autour de nous, qu’ils s’entassent, nous submergent. Nous cessons de les comprendre, de les maîtriser. Chacun d’eux nous dit quelque chose, mais quand il y en a trop ils font un tel vacarme qu’ils en arrivent à nous empoisonner la vie et à nous désorienter. Nous sommes perdus dans notre espace existentiel. Les objets finissent par devenir des ennemis. Et ce n’est pas seulement un problème de riches. L’aspect financier ne change rien au caractère hostile du superflu.
Pour l’instant, en Russie, la prise de conscience du fardeau que représente le superflu ne touche pas grand monde. Trop de gens n’ont pas encore atteint la satiété, et, s’ils y sont arrivés, ils restent contraints de suivre la règle du jeu générale, encore édictée par ceux qui n’en ont pas eu assez. Mais mon inconscient collectif pressent que bientôt, très bientôt…"
Le week-end dernier, j'ai sué sang et eau pour participer à un vide-grenier. A l'aube, après un réveil pâteux et un chargement de coffre de voiture ressemblant étrangement à la fatalité du casse-tête d'un départ en vacances, je me suis retrouvé sur un terrain de baskett de quartier à étaler d'innombrables objets nous ayant appartenu, à ma femme, à ma fille et à moi-même, sur un carré délimité que nous avions recouvert de vieille couvertures. Puis, toute la journée, j'ai guetté les badeaux dans l'espoir de faire "de bonnes affaires" avec ces objets soudainement dénués de sens que nous souhaitions abandonner, mais en les monnayant. Puis je suis rentré après 10 heures de station debout pénible, harrassé. J'ai regardé chez moi, et j'ai eu la sensation d'un Tonneau de Danaïde inversé. Ou quelque chose dans le genre.
En même temps, il est un fait : j'ai le vide en horreur, et je suis très mal à l'aise dans les appartements à l'ergonomie minimaliste.
Je me dis que ce n'est peut-être pas la quantité qui tue le sacré, mais la qualité : au milieu du fouillis grotesque des objets que nous amoncellons, certains tranchent comme des idôles dans un champ : le chapeau en feutre gris de ma grand-mère, à la bordure tricotée si laide; le briquet à pierre de mon grand-père en forme de pistolet de pirate qui trône sur son présentoir en faux bois, et qui ne marche plus; l'almanach de Spirou de l'enfance de mon père; le couteau trappu très tranchant de style japonais offert par mon frère; oui, la liste est longue de ces objets emplis du sacre de ma petite vie humaine, prises ridicules sur un mur d'escalade s'élevant vers un ailleurs en forme de néant, qui prennent sagement la poussière à côté d'autres artefacts tout aussi stériles et tout aussi laids, mais dépouvus de dévotion. Et pourtant, pour éviter que l'objet sacré ne s'enferme dans son propre culte, n'est-il pas finalement plus sage d'en estourbir la portée à coups de trompe-l'oeil et d'autres pièges à intérêt superficiels ? Car l'amoncellement devient alors légèreté, connivence, là où l'objet sacré, isolé, unique, flamboyant, pèse du poids terrible de sa valeur dans le vide que l'on crée autour de lui, jusqu'à nous réduire à son silence grave.