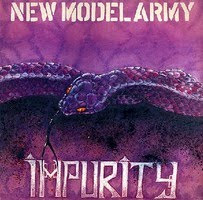Je reste abasourdi. C’est comme ça. J’arrive à me déplacer et à faire des choses utiles comme plier le linge et ranger de la vaisselle propre, et puis je dors aussi. J’ai eu froid mais c’est passé maintenant. Je vis avec un lutin bruyant et incroyablement beau et je m’habille de façon décousue en empilant des vêtements dépareillés sur des chaises. Je liste des choses à faire qui s’agencent avec sorcellerie mais je peux aussi m’asseoir sans ne rien faire pendant quelques minutes. Si je bois j’écoute un disque très fort. Si je mange c’est pour atteindre la limite de mon estomac. J’alterne mécaniquement des jeûnes tuyauteux avec des boulimies idiotes. Je m’installe derrière un ordinateur portable sans plus le déplacer, ce qui rend inutile sa fonction principale. J’attends de récupérer une connexion mais en ce moment ça ne marche pas. Je lis de très grands livres qui ne se lisent pas et dont je prends plaisir à décortiquer des extraits pleins de mots qui nécessiteraient de prendre d’autres livres qui ne se lisent pas pour en trouver le sens jusqu’à se retrouver soudainement en plein cœur de ce genre de mise en abîme intellectuelle qui vide toutes les choses de leur sens ; je lis donc d’autres livres qui ne se lisent pas non plus tellement leur bêtise est profonde, dont j’avale les phrases malhabiles les unes après les autres pour tuer le temps. Je regarde des films, même si pour ce faire je dois systématiquement réinitialiser le branchement illogique qui relie tout ce tas d’appareils qui trônent en déséquilibre dans ma chambre. Tout ça ressemble au local technique d’une PME. Parfois il faut que je chausse des lunettes, ce qui me donne des nouvelles raisons de me regarder dans des miroirs. Je regarde aussi mon visage et mon corps sur de nouvelles photos, mais ça ne me fait plus le même effet qu’avant. J’ai souvent froid aux pieds et pour autant je ne prends pas le temps de mettre des chaussettes parce que ce geste m’ennuie. Je m’étonne de moins aimer le café ; inversement, il me vient souvent dans la journée l’envie pressante et inexpliquée de conduire ma voiture. Je suis beaucoup allé marcher dans le centre-ville alors qu’à cette époque de l’année, la densité de la foule et la frénésie avec laquelle elle grouille aux portes des magasins m’épuise généralement très vite. J’ai la sensation très déstabilisante d’avoir acheté énormément de choses alors que les chiffres de mes comptes bancaires restent bizarrement optimistes ; j’aurais préféré une Bérézina financière et la culpabilité qui l’aurait accompagnée. Je construis un temple d’objets hétéroclites comme un meuble en kit à la force titanesque. Je voudrais découvrir de nouvelles pièces dans l’appartement que j’occupe depuis onze ans. J’ai l’impression que ma femme me suit. J’éprouve très souvent le besoin de me brosser les dents, plusieurs fois dans l’après-midi. J’ai peint des animaux en papier mâché à l’aide d’un gel pailleté transparent ; une otarie, et un dauphin. Je les ai mis au pied d’une lampe. Le temps est si gris qu’il est possible que rien n’existe vraiment derrière les fenêtres. Hélas dès que l’on sort tout est là, presque avec des couleurs et la magie s’effondre et il ne reste qu’à marcher vers quelque part comme d’habitude. Il y a trop de licornes dans notre appartement, et moi, j’ai toujours eu peur des chevaux. Je vis avec un lutin bruyant et incroyablement beau et ma femme me suit.
(redémarrage du système)
Je sais que je viens de passer un anniversaire supplémentaire mais comme les autres, il n’a pas marché et le temps continue donc de pouvoir être compté à l’extérieur mais pas dans moi, où il file sans à-coups si bien qu’il faut que je guette des choses sur mon corps pour ne pas être surpris. Ma mère s’est transformée en ma grand-mère qui est morte. Je continue obstinément à fumer des cigarettes sans plus la moindre envie et dans les toilettes, sur un meuble argenté normalement fait pour les salles de bain il y a une méthode pour aider les femmes à arrêter de fumer dont il est dit à l’intérieur qu’il faut la lire d’un trait sans s’arrêter pour qu’elle fonctionne. Le placard est rempli de petits sachets de bonbons mais il n’y en a aucun de ceux que j’aime et qui me font me lever la nuit en ayant froid. Pour des raisons obscures nous avons inter-changé toutes les lampes de la maison si bien que la plupart d’entre elles semblent incongrues à la place qu’elles occupent. Il va bientôt falloir déménager.
(redémarrage du système)
Je sais que je viens de passer un anniversaire supplémentaire mais comme les autres, il n’a pas marché et le temps continue donc de pouvoir être compté à l’extérieur mais pas dans moi, où il file sans à-coups si bien qu’il faut que je guette des choses sur mon corps pour ne pas être surpris. Ma mère s’est transformée en ma grand-mère qui est morte. Je continue obstinément à fumer des cigarettes sans plus la moindre envie et dans les toilettes, sur un meuble argenté normalement fait pour les salles de bain il y a une méthode pour aider les femmes à arrêter de fumer dont il est dit à l’intérieur qu’il faut la lire d’un trait sans s’arrêter pour qu’elle fonctionne. Le placard est rempli de petits sachets de bonbons mais il n’y en a aucun de ceux que j’aime et qui me font me lever la nuit en ayant froid. Pour des raisons obscures nous avons inter-changé toutes les lampes de la maison si bien que la plupart d’entre elles semblent incongrues à la place qu’elles occupent. Il va bientôt falloir déménager.