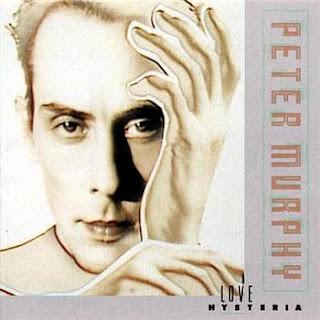Voici le troisième d’une série de 20 poèmes, qui seront postés durant 20 jours.
Lorsqu’en pleine crise adolescente j’ai découvert que Charles Baudelaire dédiait mon nouveau livre de chevet, ses Fleurs Du Mal, à Théophile Gautier, j’en ai été à la fois abasourdi, puis incroyablement offusqué et enfin déçu : comment cet auteur de mon enfance, qui m’avait certes fait adorer la lecture, à qui je devais, certes, d’avoir tant joué dans les cours de récréation ou entre les murs de la chambre que je partageais avec mon frère, les scènes épiques du Capitaine Fracasse ou du Roman de la Momie, mais que je venais de conspuer - au même titre que Walter Scott et Enid Blyton- au rang des « auteurs pour merdeux », se retrouvait-il cité à l’ouverture du noir ouvrage romantique qui marquait si bien, et avec tant de force, ma récente – et intraitable - rupture d’avec mes lectures passées ?
Pourquoi venait-il donc s’étaler en travers de mes nouvelles amours littéraires ô combien plus nobles et les souiller ainsi de son spectre infantile? Pire, pour quelle incompréhensible raison Charles Baudelaire dédiait-il donc son œuvre si romantiquement sulfureuse au père de Tahoser ?
Confus, agacé, inquiété par une possible remise en cause de l’intégrité de mon nouveau héros, je me résignai à passer outre cette provocation, reniant son intérêt et sa raison, et me plongeai dans Les Fleurs du Mal, puis dans tout Baudelaire comme dans un bain brûlant aux essences délétères, déjà ivre d’odeurs, de sexe opaque, de drogues et de rimes divines…
De nombreuses années plus tard, le hasard me remit face à Théophile Gautier, au détour d’une page de cette vieille Anthologie des Poètes Français de Jacques Imbert, magnifique ouvrage de cinq cent soixante neuf pages acquis sur ordonnance d’un professeur de français éclairé lors de mes années de lycée, et dont je ne m’étais plus jamais séparé depuis.
Là, comme la mer rouge s’ouvrant sur ordre de Moïse, l’étendue vertigineuse du talent de Théophile Gautier m’engloutit enfin, et dans une délicieuse noyade au scintillement mystique tout baudelairien, je compris enfin la clé du mystère m’ayant autrefois tant contrarié : non content d’être un incroyable romancier, Théophile Gautier était un poète fondamental.
Aujourd’hui, je ne sais, entre ces deux figures tutélaires contemporaines l’une de l’autre, laquelle me fascine le plus : d’un côté, Charles, l’orphelin d’un père peintre prêtre défroqué qui se rêve « tantôt pape, tantôt comédien » : échappant d’un exil forcé aux Indes décrété par un beau-père militaire en réaction à ses velléités artistiques, il revient réclamer son héritage qu’il dilapide en deux ans avant d’être soumis à un conseil judiciaire par sa propre mère écœurée de ses excentricités ; il passera dès lors sa vie à fuir les créanciers, rongé par la syphilis et sa fascination pour Edgard Allan Poe, finissant ses jours hémiplégique, abruti des brouillards morbides de l’éther et de l’opium en 1867, à 46 ans.
De l’autre, Théophile, de dix ans son aîné, inversement encouragé par sa famille à suivre la voie de la peinture, dont une seule rencontre avec Hugo le conduira finalement à la poésie ; le « bon Théo », connu pour son penchant pour la bagarre – en véritable dandy, il fait le coup de poing en gilet de satin rouge -, épousera une danseuse italienne qui le condamne au journalisme pour subvenir aux besoins de leurs filles avant de finir sa vie à Neuilly de la façon la plus paisible qu’il soit, entouré d’une troupe d’admirateurs en 1872, à 61 ans.
Ainsi, en excuse à Théophile Gautier – et espérant peut-être lever le voile sur un tel talent à quelque infortuné comme je le fus - , voici le sublime « A une robe rose » :
Que tu me plais dans cette robe
Qui te déshabille si bien
Faisant jaillir ta gorge en globe,
Montrant tout nu ton bras païen !
Frêle comme une aile d’abeille
Frais comme un cœur de rose thé,
Son tissu, caresse vermeille,
Voltige autour de ta beauté.
De l’épiderme sur la soie
Glissent des frissons argentés
Et l’étoffe à la chair renvoie
Ses éclairs roses reflétés.
D’où te vient cette robe étrange
Qui semble faite de ta chair,
Trame vivante qui mélange
Avec ta peau son rose clair ?
Est-ce la rougeur de l’aurore,
A la coquille de Vénus,
Au bouton de sein près d’éclore,
Que sont pris ces tons inconnus ?
Ou bien l’étoffe est-elle teinte
Dans les roses de ta pudeur ?
Non ; vingt fois modelée et peinte,
Ta forme connaît sa splendeur.
Jetant le voile qui te pèse,
Réalité que l’art rêva,
Comme la princesse Borghèse
Tu poserais pour Canova.
Et ces plis roses sont les lèvres
De mes désirs inapaisés,
Mettant au corps dont tu les sèvres
Une tunique de baisers.